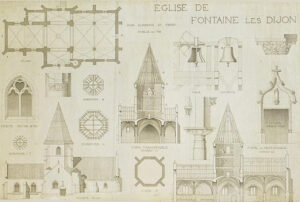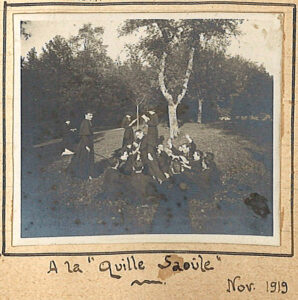Tibériade, vue générale et extrait désignant l’emplacement des villages, métairies, chemins, rivières d’Ouche et de Suzon dépendant de la banlieue de Dijon, 1717 © Archives municipales de Dijon.
Pour les 10 ans de l’inscription des climats au patrimoine mondial de l’UNESCO, les archives municipales de Dijon ont exposé en salle de lecture des plans qui témoignent de la présence ancienne de la vigne à Dijon et aux alentours, notamment la Grande Tibériade du XVIe siècle au format spectaculaire. Si Fontaine est absente de cette dernière carte, qui représente la vallée de l’Ouche, en revanche le territoire de la commune apparaît dans une tibériade plus tardive datant de 1717[1]. Ce plan non coloré, collé sur toile, monté sur corniches en bois en haut et en bas, mesure environ 1,44 m de large sur 1,34 m de hauteur.
En Bourgogne, à partir de la seconde moitié du XVe siècle, les tibériades sont des cartes dressées pour représenter la situation de lieux de contentieux. La tibériade de 1717, qui comporte une échelle en perches, chaque perche ayant 19 pieds (6,13 m), a été commanditée par la Ville de Dijon, l’abbaye Saint-Étienne et l’abbaye Saint-Bénigne, pour établir, à frais communs, les confins de la banlieue de Dijon et représenter ainsi les droits respectifs de chaque partie. Sur un tel plan, il ne faut pas chercher une restitution exacte de l’espace. Seuls les lieux litigieux, c’est-à-dire les franges de la banlieue sont représentées. Comme le territoire de Fontaine est entièrement compris dans la banlieue de Dijon mais que ni Talant, ni Daix n’en relèvent, les frontières de la banlieue sont celles du finage de Fontaine avec ceux de Talant et Daix. En revanche, la séparation entre le finage de Fontaine et celui d’Ahuy avec ses décrochements caractéristiques, n’apparaît pas, car seul le tracé de la banlieue est marqué et dessine à cet endroit une ligne droite de la croix de la Fin de Fontaine, située à l’entrée de la ruelle au Beau qui fait partie d’Ahuy, à la croix de la Maladière sur le chemin de Messigny (aujourd’hui de Dijon) à Ahuy. La banlieue mord donc sur une petite partie d’Ahuy d’où d’incessants conflits de juridiction avec l’abbaye de Saint-Étienne dont Ahuy relevait. C’est pourquoi à Ahuy, de nouvelles bornes sont posées, ce qui n’est pas le cas entre Fontaine, Daix et Talant.
Comme ces cartes ont pour origine des conflits de limites, elles résultent d’enquêtes minutieuses réalisées sur le terrain. C’est ainsi que le territoire de la banlieue est arpenté et borné, en vertu de la délibération de la Chambre de Ville du 21 août 1715[2], par André Gambu père, tandis que la carte est dessinée par Bernard Gambu fils, arpenteur-juré du roi en la maîtrise particulière des Eaux et Forêts[3]. Il a fallu 18 jours au père entre 1715 et 1717 pour reconnaître le tracé et 10 au fils pour dresser la carte. Le paiement de ce travail est acquitté entièrement par le receveur de la Ville en 1723[4]. Pour reconnaître le finage de la banlieue de Dijon, l’arpenteur est accompagné par Chenevet, échevin de la Ville de Dijon, et par deux experts désignés par les abbés de Saint-Étienne et de Saint-Bénigne et agréés par la Ville, les nommés Jeoffroy, vigneron demeurant rue Roulotte à Dijon et Debonnaire, manouvrier au faubourg Saint-Nicolas.
Dans ce document, même si le village de Fontaine est grossièrement symbolisé, on devine une modeste bourgade dont les maisons sont groupées au pied de la colline dominée par l’église et le monastère des Feuillants. Le dessin de ce dernier est sommaire, mais suffisant pour montrer le bâtiment neuf construit par les moines, ainsi que le clocher-tour de leur église surmonté d’un lanternon et d’une croix. La carte fournit également des détails sur les grands vignobles de l’ouest de la commune et précise leur toponymie : Grands-Champs, Combottes, Créots, « Juttriot » en limite de Talant, les Côtes d’Ahuy et les vignes « dittes Les Clos de Baise » en limite de Daix[5]. Cette dernière appellation pourrait désigner une propriété possible de l’abbaye bénédictine de Bèze par le passé. Le reste du paysage est constitué de terres tandis que les Charmes d’Aran, comme leur nom l’indique, sont des friches aux contours nets et biens délimités.
Cette tibériade offre aussi des informations sur les repères spatiaux retenus par les enquêteurs. Pour Fontaine, il s’agit de trois croix. La croix au carrefour des 5 rues (actuellement Arandes, Bourgogne, Grands-Champs, Combottes, Herriot) est accompagnée à proximité d’une borne plantée sur le chemin de Daix à Dijon pour limiter la banlieue avec Talant et d’une autre à l’angle de la rue des Arandes et de la rue Herriot. Celle sur le chemin de Daix est en pierre blanche, haute d’1 pied et ½ (48 cm), épaisse de 6 pouces (12,5 cm). Elle est aux armes de Dijon sur une face et porte la date de 1570, tandis que l’autre face est brute, comme la borne actuellement conservée dans la tour de la Confrérie à Talant[6]. La croix d’Aran, au milieu du carrefour de l’actuel chemin des Charmes d’Aran et de la rue des Peupliers, sert quant à elle de borne à la banlieue de Dijon avec les finages de Talant et de Daix tandis que la croix de la Fin de Fontaine, à l’entrée d’Ahuy, comporte en plus une borne à son pied. Toutes ces croix et bornes inviolables, fruits de siècles de combats et de négociations et qui n’avaient rien de décoratif, ont été effacées alors que ces monuments rendaient perceptibles des délimitations restées dans le dessin actuel de la commune. Quant aux chemins et grands chemins, ce sont ceux d’aujourd’hui sous des appellations parfois différentes comme la D 107 pour le chemin de Daix.
Cette carte est donc une source iconographique importante par les tracés qu’elle fournit, aussi bien que par les informations qu’elle donne sur des éléments de paysage d’un des confins de Fontaine au XVIIIe siècle.
Sigrid Pavèse
[1] Archives municipales de Dijon (AMD), 4 Fi 778.
[2] AMD, K4 : Requête adressée au maire et aux échevins par Bernard Gambu pour paiement des journées employées, 3 février 1720. À cette date, André Gambu père étant décédé, Bernard en a les droits.
[3] Bernard Gambu et son père André sont connus pour avoir réalisé l’Atlas de Cîteaux.
[4] AMD, K4 : Paiement de 100 livres le 21 mars 1722 et de 140 livres le 20 novembre 1723.
[5] Tous ces toponyme figure sur le cadastre napoléonien à l’exception des « des Clos de Baise ».
[6] https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00112685 La notice indique 1370, mais il s’agit bien de 1570. Cette borne serait l’une des deux bornes indiquées dans la tibériade et situées à l’angle du boulevard des Clomiers et de la route de Troyes.